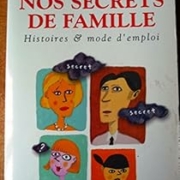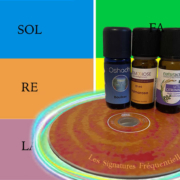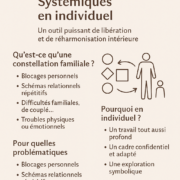Secrets, fantômes et transmissions : de l’indicible à la mise en sens
Le secret de famille ne se résume pas à un non-dit : il est souvent interdit de le connaître et même d’en imaginer l’existence. À la première génération, le secret est indicible — lié à un traumatisme ou à la honte. À la deuxième, il devient innommable — l’enfant pressent mais n’a pas le droit de nommer. À la troisième, il devient impensable — plus aucune représentation consciente n’en subsiste, mais le corps, les rêves ou les comportements en conservent la trace.
L’écoute transgénérationnelle vise à rétablir la continuité de sens entre ces trois temps du silence.
Le praticien doit d’abord clarifier cette distinction avec ses patients et rester attentif aux familles affirmant « nous ne cachons rien » — formulation fréquente lorsqu’existe un interdit de même imaginer un secret.
Le travail thérapeutique demande prudence : ni confrontation directe ni interprétation prématurée, mais exploration progressive des zones muettes, parfois à travers les rêves, les images ou les symptômes corporels.
Rêves et traces du non-dit
Le rêve agit comme un messager entre générations. Il convient d’encourager l’écriture immédiate des rêves pour préserver leurs formulations exactes et de distinguer ceux qui marquent par leur intensité émotionnelle. Leur interprétation doit rester ouverte : mieux vaut accueillir leur portée symbolique et temporelle plutôt que forcer le sens.
Certains rêves font écho à des faits familiaux refoulés — maladies, morts, ruptures — qu’ils réinscrivent dans un langage poétique là où la parole s’est tue.
Les images et les enfants : révélateurs de l’impensé
Dans un monde saturé d’images, certaines bouleversent non par leur contenu immédiat mais par leur résonance transgénérationnelle. Un film, une scène, une peinture peuvent réveiller un souvenir familial non formulé. Les enfants, plus proches de l’inconscient collectif familial, traduisent souvent ces résonances en paroles simples : « Mais dis-lui donc que tu es son père ! » dit un enfant en regardant Bambi — donnant voix à la question de filiation refoulée d’un parent.
Ces réactions ne doivent pas être banalisées : elles constituent des indices cliniques précieux, permettant d’aborder en douceur les non-dits.
L’alliance mère-bébé : prévention des transmissions symptomatiques
Lorsqu’une jeune mère traverse des crises intenses – deuil, rupture, conflits familiaux –, le bébé devient le premier témoin et parfois le porteur des tensions. Un nourrisson qui ne dort plus n’exprime pas qu’une « période pénible » : il peut réactiver un fantôme familial en souffrance.
Le soin consiste alors à reconstruire une alliance d’amour et de confiance mère-bébé : c’est une véritable prévention transgénérationnelle. En apaisant la mémoire du traumatisme à travers la relation vivante, on empêche la répétition inconsciente dans les générations futures.
Le fantôme transgénérationnel
Pour Nicolas Abraham, le fantôme est un objet inconscient transmis d’un inconscient à l’autre, formé autour d’un secret lié au sexe ou à la mort. Il ne provient pas du vécu oublié de la petite enfance, mais du vécu oublié des ascendants.
Ses manifestations sont variées : phobies, troubles corporels, symptômes obsessionnels ou hystériques.
Une fillette, par exemple, terrorisée par les « pieds nus », rejouait inconsciemment le secret familial d’un grand-père pendu — pieds nus / pendus. Le sens, révélé plus tard, a permis d’apaiser l’angoisse et d’éviter une nouvelle transmission.
Ce n’est pas la vérité historique qui soigne, mais la mise en sens et la réintégration symbolique du non-dit.
Psychophanie : une voie d’expression du non-conscient
La psychophanie, inspirée de la communication facilitée, permet parfois de donner forme à des contenus inconscients enfouis. Le patient, accompagné d’un facilitateur, laisse émerger des mots au clavier : métaphores, symboles, fragments d’histoires.
Ces productions ne doivent jamais être tenues pour des vérités factuelles : elles expriment une vérité psychique, non historique. Le but n’est pas la révélation du secret, mais la reconstruction d’un sens apaisant. Le praticien veille à son influence, au cadre éthique et à l’intégration de ce travail dans une démarche thérapeutique globale.
Psyché pré-langagière et enfants explorateurs du transgénérationnel
Certains enfants psychotiques semblent habiter une réalité parallèle, proche du chamanisme ou de la psyché pré-langagière. Leurs dessins, gestes ou silences expriment souvent l’impensé généalogique.
Plutôt que de pathologiser ces phénomènes, il faut les décrypter comme un langage symbolique, manifestation de la mémoire familiale. L’enfant devient alors un explorateur des zones d’ombre du clan, que l’adulte doit traduire sans effroi.
Une méthodologie relationnelle prudente
Pour aborder les secrets, Serge Tisseron recommande des formulations impersonnelles :
« J’ai l’impression qu’un jour, quelqu’un dans notre famille a caché quelque chose. »
Cette approche non accusatoire ouvre l’alliance et évite la fermeture défensive.
L’objectif n’est pas de révéler mais de confirmer, de co-construire un récit cohérent et soutenant.
La vérité complète importe moins que la libération du sens et la continuité retrouvée entre les générations.
Au cœur de ces approches, le thérapeute devient passeur : il relie le visible et l’invisible, le rêve et le réel, l’histoire et la mémoire. Dans cette écoute, les fantômes trouvent enfin des mots pour cesser de hanter les nuits familiales — et laisser, à la place, une paix transmise.